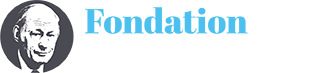René Lévesque
Source : Jean Paré, «“interview” René Lévesque», L'Actualité, septembre 1976, p. 6-10.
Le Québec est en période électorale. C'est-à-dire que les politiques se font, que les groupes s'alignent, en fonction d'élections qui auront lieu au cours des prochains 12 mois. Élections qui seront âprement contestées, où seront débattus des problèmes dont plusieurs, qui ont durement touché les Québécois depuis un an, sont traités dans ce premier numéro de l'Actualité, élections dont l'enjeu est le plus crucial depuis qu'on en tient en ce pays. Quelle qu'en soit l'issue, 1976-77 sera sûrement l'année de René Lévesque… la première ou la dernière! (L'entrevue a été réalisée par Jean Paré.)
L'Actualité : Alors, c'est cette année?
R. Lévesque : Non!... Il y a bien des gens dans le parti qui pensent que c'est pour tout de suite, même fin août. Moi, je suis convaincu que Bourassa n'a pas encore choisi sa date… et que la pression fondamentale du caucus, de la centaine de députés qui accumulent de la pension chaque année, c'est laissez-nous faire nos quatre ans. J'ai parié pour l'automne 1977.
Le problème empoisonnant que ça pose, c'est que Bourassa, malgré ses promesses, n'a pas réglé le cas de la carte électorale. Est-ce que les élections vont avoir lieu avant ou après la nouvelle révision de la carte? Ça implique des chambardements importants, surtout dans la région de Montréal, les listes de membres à ajuster, les conventions à tenir. Nous, on ne sait pas sur quel pied danser, se préparer pour la carte de 1973 ou pour la nouvelle. Les gens au pouvoir, eux, ils peuvent se télégraphier ce qu'ils veulent. Sans compter qu'ils ne sont pas trop exigeants sur l'établissement des listes de membres…
Les choses qui inquiètent le monde
L'Actualité : Le «Manifeste des priorités du Québec», que vous avez annoncé, où est-ce que c'en est?
R. Lévesque : Ça va être prêt pour l'édition d'un moment à l'autre, en septembre ou octobre… Ça va être autre chose qu'un programme, une réflexion – où on pourra piger pour le programme – sur les choses les plus concrètes, les choses qui inquiètent le monde, comme la santé, l'éducation, l'économique.
Ça va être concret, et englobé si possible avec les échéances auxquelles les gens s'attendent. Il ne faut pas faire trop de futurisme. C'est drôle : il y en a qui trouvent qu'on s'affadit à mesure qu'on essaie de devenir plus concret, plus rationnel. Il faut précéder l'évolution d'une société, mais ne pas perdre le contact. Oublier le prophétisme, ça met de la substance perceptible pour la population. Si on ne perd pas la direction, la «traque» de l'avenir…
L'Actualité : Et ça ressemble à quoi, la «traque» de l'avenir?
R. Lévesque : L'option fondamentale du parti, ça ne change pas. Ça reste l'indépendance politique. La souveraineté. Pour le reste, on nous a baptisés – on n'a pas cherché l'étiquette – des sociaux-démocrates. Moi, j'y crois. Social-démocrate, ça veut dire deux choses essentielles : l'égalité des chances, et la définition de nouvelles formes de pouvoir.
L'espèce d'hypercentralisation, de bureaucratisation qui s'est établie de plus en plus en politique et dans les services publics, c'est quelque chose que les gens vomissent, et ils ont raison. Les formes institutionnelles traditionnelles du pouvoir sont dépassées : ça peut pas se changer du jour au lendemain, il faut trouver un rythme, ne pas bousculer les gens. C'est dur pour nous de réajuster notre programme : le parti a émergé à la fin des années soixante, dans l'euphorie de la révolution tranquille. Il suffisait de mettre des structures sur papier, des régies, des planificateurs, des jargonneux, pour régler les problèmes. On se rend compte aujourd'hui que ça risque de les empirer.
Ça va aussi dans l'entreprise. Les Scandinaves, les Allemands de l'Ouest, même les Américains ont développé la nouvelle définition des centres de décision dans les entreprises. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va passer d'un coup d'une structure très traditionnaliste à l'autogestion à la carte. Prenons Tricofil : c'est un cas unique de gens qui ont grandi avec leur entreprise, qui en connaissent chaque brique. Dans le cas du Jour, par contre, on a fait une expérience plutôt sanglante : on a essayé une sorte d'utopisme généreux dans un journal nouveau, fragile, dont la production change six fois par semaine, avec une équipe, une structure improvisées… On voit les résultats.
L'Actualité : Pour l'autre volet de la social-démocratie, l'égalité des chances, est-ce que la réforme de l'éducation n'était pas faite dans cette intention?
R. Lévesque : On a eu la démocratisation quantitative. Avec les écoles secondaires, les cégeps, les nouveaux campus, on a augmenté comme jamais l'accessibilité aux études. Mais il ne faut pas se faire d'illusion : c'est loin d'être complet. Ça m'horripile de constater que la scolarisation de nos 16 à 20 ans, qui est le tremplin pour la formation de cadres professionnels et techniques, est encore la moitié de ce qu'elle est aux États-Unis. Que notre taux de fréquentation collégiale et universitaire est moins élevé que celui de minorité anglophone…
L'Actualité : Vous voulez recommencer à zéro?
R. Lévesque : Surtout pas. Un système d'éducation, ça ne se chambarde pas comme on change de chemise. On a épouvantablement charrié, dans les contenus, dans un gigantisme niais. Il ne s'agit pas de retourner au bon vieux temps. Le rapport Parent prévoyait des écoles secondaires ne dépassant pas 1 000 à 1 200 élèves : ce qui est frappant, c'est que les seuls endroits où le secondaire a l'air en santé sont les milieux ruraux où la faiblesse de la clientèle a permis de ne pas dépasser cette taille là.
L'Actualité : Mais comment décentraliser? En donnant plus de pouvoir aux commissions scolaires?
R. Lévesque : Le ministère de l'Éducation de la Suède – un pays de 8,5 millions d'habitants, épars sur un grand territoire – a combien de fonctionnaires?... Cent! Une centaine, sous lesquels travaillent à peu près 600 personnes-ressources dans les régions, pour les manuels, la recherche... Ici, le ministère est un monstre, où on fricote, on chinoise sur à peu près tout. Et à l'autre bout, des commissions scolaires devenues, littéralement, irresponsables.
Ce qu'il faut garder, c'est des normes salariales, pour éviter les disparités d'autrefois, le contrôle des programmes et des manuels-clés, des brevets et des diplômes. Pour le reste, le ministère devrait être tout petit… un lieu d'expertise.
L'Actualité : Et comment redonner du pouvoir aux Commissions scolaires? En leur remettant davantage d'impôt foncier?
R. Lévesque : Qu'est-ce que c'est que cette manie qu'il faille payer des taxes directes pour avoir des pouvoirs? Premièrement, il faut éliminer la taxe scolaire, qui mange les revenus municipaux, et éventuellement diminuer l'assise de la taxe foncière qui est un impôt régressif au point de vue social, et arriver à ce que les Commissions scolaires soient totalement subventionnées. Et d'autre part, qu'on leur donne des pouvoirs : que l'élection se fasse non plus sur cette espèce de base pseudo-démocratique, mais par désignation de groupes intéressés, de comités de parents et d'usagers des écoles, des représentants des groupes culturels, des syndicats, des milieux d'affaire.
En dehors des normes dont on parlait, qu'on leur envoie le budget et qu'ils l'aménagent selon les besoins régionaux. Il va y avoir des bêtises, du gaspillage, mais vont-ils en faire plus que le Ministère?
L'Actualité : Et l'autre gros bobo, la santé?
R. Lévesque : Là encore, c'est une question de structures. Les hôpitaux sont pris comme des individus devant un ministère qui est lui aussi un monstre. Il serait important d'établir les vrais besoins des régions en hôpitaux généraux bien équipés, comment répartir les cliniques, les CLSC. Et là encore, il faut que les gens des régions soient responsables. Les normes doivent rester des normes – salariales, de traitement, de nombre de lits. L'administration et le développement doivent être remis aux régions. Parce que le gaspillage vient du vacuum entre les chinoiseries bureaucratiques et l'irresponsabilité locale. Ça ouvre la porte au tripotage, et pas seulement au tripotage classique qu'est le patronage, mais aux excès des bureaucraties syndicales. On a vu, récemment, c'est le moins qu'on puisse dire, de la manipulation, des faux-semblants…
L'Actualité : Mais c'est une question de coûts. Ils sont plus élevés qu'en Ontario, alors qu'on n'a pas plus de personnel, ni mieux payé…
R. Lévesque : Et les gens ne sont pas non plus mieux soignés. C'est comme en éducation. D'après des chiffres récents, le Canada est le pays occidental le plus bureaucratisé en éducation : de 35 à 40 pour cent des budgets de l'éducation vont à l'administration. Et au Québec, tenez-vous bien, ça atteint 55 pour cent. C'est effarant!
L'Actualité : Et la rémunération des médecins. Il y en a qui touchent plus d'un demi-million par année. Estimez-vous nécessaire de changer le régime?
R. Lévesque : Il y une sorte de compression tranquille qui peut se faire. Il suffit – et on le fait – d'appliquer rigidement la loi de l'impôt. Pour le reste, il va falloir au moins une génération : il va falloir former, dans les Facultés de médecine, une autre race de médecins. On pourrait commencer par demander, pour les premières années de pratique, un service obligatoire dans les régions défavorisées. Ça pourrait s'appliquer aussi en éducation. Et on finirait par arriver à une forme de salariat qui tient compte de l'utilité de la profession, de la longueur des études, de la dureté du travail. Il y a moyen d'arriver à des calcules raisonnables.
L'Actualité : Et sur la surconsommation des soins?
R. Lévesque : Quitte à inclure ça dans les prestations des assistés sociaux, je serais pour qu'on ait une forme quelconque de tickets modérateurs. Une piastre, peu importe. Le même principe pourrait s'appliquer aux médicaments, le jour venu, parce que ça aussi, il faut que ça vienne, un bon jour!
Le Québec est, comme le Canada, une société ouverte.
C'est une fraude de prétendre contrôler les prix!
L'Actualité : L'inflation, comment ça se contrôlerait sous un gouvernement péquiste? Par un contrôle des prix?
R. Lévesque : Écoutez. Je ne voudrais pas fabriquer une réponse magique. On n'a pas encore été un gouvernement et ceux d'entre nous qui y ont été, les Morin, les Parizeau, n'ont pas vécu cette inflation massive et permanente. Une chose sûre, c'est que le Québec, comme le reste du Canada, est une économie très ouverte : on importe jusqu'à 40 ou 50 pour cent de ce qui est sur nos marchés. Et c'est une fraude monumentale de prétendre contrôler les prix comme les salaires. Je pense qu'il y a une éducation économique à faire, que c'est un problème moral, en un sens.
L'Actualité : C'est la nouvelle société de Trudeau?
R. Lévesque : Trudeau n'a pas nécessairement toujours tort!
L'Actualité : Et le grand chiard olympique, faudrait-il s'attendre à une enquête?
R. Lévesque : D'abord, on est pris avec. L'éléphant blanc du siècle. Sans faire des enquêtes spectaculaires, ce qui est trop facile, il va falloir étudier le dossier, aller au fond, parce qu'il y un enseignement à en tirer. La même chose, d'ailleurs, avec la Baie James. . .
Il y a déjà des fonds qui sont engagés, dépensés peut-être. On ne peut que continuer. Et ce qu'on peut faire, c'est étaler, rythmer les dépenses. Mais il va falloir étudier le délire d'attribution de contrats qu'il y eu en 1971 et 1973. L'inflation expliquerait qu'on passe de cinq ou six à huit ou 10 millions, mais pas à 17 ou 18.
L'Actualité : Le projet de création d'un Parti des travailleurs, est-ce que ça vous inquiète?
R. Lévesque : Il n'y a pas de parti des travailleurs dans le paysage. On y viendra, mais actuellement, c'est de la fiction. On n'est même pas capable, dans les milieux qui le proposent, de définir le terme de travailleur. Et ça n'a pas de prise sur la base, sur les travailleurs eux-mêmes. Un jour ou l'autre, dans un Québec indépendant, on espère que le PQ va donner naissance à d'autres partis, qu'il y aura tout l'éventail, de gauche à droite. C'est une meilleure garantie de renouvellement…
A ceux qui disent que c'est la fin du monde,
répondre que c'est le commencement de l'avenir
L'Actualité : Estimez-vous qu'il vous serait plus facile de négocier l'indépendance avec un Trudeau, ou un Joe Clark?
R. Lévesque : Ils ont tous le même mandat : sauver le régime tel qu'il est. Ça ne serait pas plus facile, pour l'essentiel, avec l'un qu'avec l'autre. Si ça se règle de façon civilisée, ça va se faire par pression politique. Quoi qu'il y ait à Ottawa, il faut passer par l'étape électorale, on ne peut pas la sauter, quoi qu'en pensent certains.
Là, on se trouve devant un gouvernement fédéral, où il y a des gens élus par les Québécois, qui sont légitimes aussi. Donc, deux légitimités, une élue pour faire l'indépendance, l'autre pour l'empêcher, parmi d'autres objectifs. C'est schizophrénique, d'accord, Mais c'est schizophrénique, un régime fédéral.
En deuxième étape, on peut se chicaner indéfiniment, faire du «fédéral-provincial», on n'en sortira jamais. Ou faire une déclaration unilatérale d'indépendance : quelle force on aurait aux Nations Unies, advenant un conflit? Pas très épais. La plupart des pays, surtout les jeunes nations, n'ont pas intérêt à encourager les sécessions.
Il resterait à mener l'affaire le plus vite possible en éclairant le dossier, et tenir le référendum. Aux gens d'Ottawa qui prétendraient que c'est la fin du monde, répondre que c'est le commencement de l'avenir. Ça crée une pression politique classique dans une société anglo-saxonne qui a une certaine tolérance, qui tient à certains principes, qui veut éviter une tension internationale quand une majorité de citoyens ont dit oui sur une question.
L'Actualité : Aux pressions politiques de l'État québécois, vous prévoyez sans doute que vos adversaires opposeraient des pressions économiques, une sorte de guérilla de la récession…
R. Lévesque : Ce genre de pouvoir, on l'exagère beaucoup. Désactiver négativement l'économie, ça prend un certain temps. Et le régime courrait au suicide s'il tentait de disloquer la substance même du Québec à l'intérieur d'un pays qui a ses normes fiscales ou administratives.
On a des perspectives internationales, mais mal ajustées. On a des schémas chiliens, bengalis, biafrais, mais il faut arrêter de s'imaginer que c'est possible en Amérique du Nord… On va nous offrir une série de carottes fédérales, mais le bâton, ça serait pas plus que de la propagande.
L'Actualité : Vous dites que les électeurs vous considèrent de plus en plus comme des gens qui ont mérité le pouvoir. D'après vous, quelles sont les zones où le vent vous semble favorable?
R. Lévesque : On a fait des sondages, comme tout le monde. On a sondé de 200 à 300 personnes par comté dans plus de 40 comtés. Et à part le bloc anglophone de l'ouest de Montréal, je ne vois pas de régions où on n'est pas en avant des libéraux. Ça varie de 35 à 40 pour cent…
L'Actualité : Vous avez déjà dit ça!
R. Lévesque : À part l'optimisme de commande des campagnes électorales, je n’ai jamais dit ce que je dis cette année. Vous pouvez vérifier. L'Union nationale est une force de nuisance qui va toucher surtout les libéraux. Nous, on a fait la preuve, statistique, calculée, d'une stabilité extraordinaire. Si l'Union nationale attrape les 20 pour cent dont ils rêvent, et ne se vend pas, on y est…
L'Actualité : En 1960, vous étiez entré en politique pour combien de temps?
R. Lévesque : Ce qui m'intéressait surtout comme expérience, à titre de journaliste, c'était de passer à travers l'élection. J'ai passé à 127 voix de retourner à mon métier! Puis en 1962, lors de la nationalisation de l'électricité, je me suis dit que je ferais le point en 1965-66. Là, à la défaite, j'ai été amené à travailler avec des libéraux à des études qui nous ont menés au Mouvement Souveraineté-Association. Ça n'est pas que l'opposition me tentait : c'est un sacré sacrifice, l'opposition. On est exposé à devenir un chiqueux de guenille professionnel; on ne produit pas, on est essentiellement critique. C'est pour ça que j'ai autant d'admiration pour nos six gars, qui tiennent le coup depuis cinq ans…
Puis il y a eu l'élection de 1970. J'ai eu ensuite une période de réflexion de cinq mois : j'aurais aimé passer la main, mais on m'a demandé de rester. Après 1973, on était plus fragiles, avec des tiraillements, et j'ai décidé de franchir une autre étape. Là, on espère avoir un minimum de 30 députés, franchir le mur du son. Si j'en suis, il va bien falloir continuer, sinon, je vais accrocher mes patins.
L'Actualité : Vous avez eu, en 13 ans, cinq campagnes très dures. Vous n'êtes pas fatigué?
R. Lévesque : Par bouts! Ces retraites, qu'on m'a reproché, c'est ça qui permet de recharger les batteries, intellectuellement et physiquement. La question qu'il faut se poser, c'est : est-ce que je suis encore productif? Je suis le seul dans le parti, avec le Dr Lussier, qui ne veut pas être candidat, à avoir participé à un cabinet. Comme Lesage était le seul en 1960. Si on ne l'avait pas eu…
L'Actualité : Est-ce que René Lévesque éloigne des partisans possibles, ou est-ce qu'on vote encore pour Lévesque plutôt que pour le parti?
R. Lévesque : Je pense que oui, mais de moins en moins. Au début, j'étais le seul connu, mais ça n'est plus vrai. En tout cas, sans fausse modestie, je ne sais pas. Dans l'opinion, dans les média, dans le parti, il y a des gens tannés de me voir. Mais que j'aie des rivaux, c'est un signe de santé. Quant à mon image…
L'Actualité : Précisément, vous êtes-vous suffisamment soucié de votre image? Bourassa, Trudeau, Clark, jouent les pères de famille, monsieur tout le monde…
R. Lévesque : Mes enfants, deux gars et une fille, grandissaient quand j'étais dans le cabinet libéral. Et j'ai pris soin de les écarter systématiquement de ma vie publique : je considérais ça comme une forme d'exploitation commerciale. Aujourd'hui, ils sont adultes et… non, ils ne s'occupent pas de politique. Sauf pour un coup de main lors des élections. Ce sont des sympathisants, mais pas plus.
L'Actualité : Quelle liberté a René Lévesque à l'intérieur de parti?
R. Lévesque : J'ai d'abord la liberté de dissidence. Certains s'en servent pas mal, moi peu. Mais avec l'impact que ça pourrait avoir, c'est une sacrée liberté, et je m'en servirais si il y avait opposition directe sur des questions fondamentales…
Puis il y a la liberté de mes loisirs, et j'y tiens. On a besoin de vacances, de deux ou trois semaines par année…